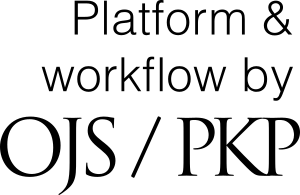Information pour les auteurs
Types de contributions et aspects généraux
Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) accepte des articles scientifiques, des articles de synthèse, des résumés de thèse de doctorat, des analyses bibliographiques, des notes et des fiches techniques, des revues de livres, des actes de conférences, d’ateliers et de séminaires, des articles originaux de recherche et de synthèse, puis des études de cas sur des aspects agronomiques et des sciences apparentées produits par des scientifiques béninois ou étrangers. La responsabilité du contenu des articles incombe entièrement à l’auteur et aux co-auteurs. Le BRAB publie par an -i- quatre (04) numéros à raison d’un numéro par trimestre, et -ii- aussi des numéros spéciaux.
Pour les auteurs, une contribution de cinquante mille (50.000) Francs CFA, tout frais compris, est demandée par article soumis et accepté pour publication. L’article publié est disponible en accès libre sur la plateforme avec notification à l’auteur correspondant.
Soumission de manuscrits
Les manuscrits doivent être soumis en ligne sur la plateforme https://brab.bj/ accompagnés d’une lettre de soumission au comité de rédaction et de publication du BRAB. Dans la lettre de soumission les auteurs doivent proposer l’auteur de correspondance ainsi que les noms et adresses (y compris les e-mails) de trois (03) experts de leur discipline ou domaine scientifique pour l’évaluation du manuscrit. Certes, le choix des évaluateurs revient au comité éditorial du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin. Les manuscrits doivent être écrits en français ou en anglais, tapé/saisi sous Winword ou Word ou Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple sur du papier A4 (21,0 cm x 29,7 cm). L’auteur doit fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et photos) en dehors du texte. Les figures doivent être réalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données ayant servi à élaborer les figures seront également fournies. Les photos doivent être suffisamment contrastées. Les articles sont soumis par le comité de rédaction à des évaluateurs, spécialistes du domaine.
Processus d’évaluation
Dès la réception du manuscrit, le secrétariat scientifique de la revue vérifie la conformité aux indications aux auteurs puis envoie un courriel à l’auteur correspondant où il lui est mentionné la suite réservée à son manuscrit. Ensuite, est déclenché le processus de l’évaluation aveugle par l’envoi aux trois (03) évaluateurs retenus par le secrétariat scientifique. Au cours de la troisième semaine, l’auteur reçoit la décision de rejet ou d’acceptation de son manuscrit sous réserve de la prise en compte des observations faites par les évaluateurs. Les auteurs ont deux (02) semaines pour retourner la nouvelle version de leur manuscrit accompagnées d’une deuxième lettre de soumission comportant un tableau synoptique dans lequel ils justifient la prise en compte ou non des observations critiques constructives des évaluateurs dudit manuscrit. Toutefois, les manuscrits ayant reçu des observations majeures sont retournés aux évaluateurs pour la vérification des observations apportées. Au bout de deux (02) semaines, ils reçoivent le proof de leur article pour une relecture en 72 heures et procède au règlement des frais de publication avant la parution de l’article sur la plateforme.
Sanction du plagiat et de l’auto-plagiat dans tout article soumis au BRAB pour publication
De nombreuses définitions sont données au plagiat selon les diverses sources de documentations telles que « -i- Acte de faire passer pour siens les textes ou les idées d’autrui. -ii- Consiste à copier les autres en reprenant les idées ou les résultats d’un autre chercheur sans le citer et à les publier en son nom propre. -iii- Copie frauduleuse d’une œuvre existante en partie ou dans sa totalité afin de se l’approprier sans accord préalable de l’auteur. -iv- Vol de la création originale. -v- Violation de la propriété intellectuelle d’autrui. » (https://integrite.umontreal.ca/reglements/definitions-generales/). Le Plagiat et l’Autoplagiat sont à bannir dans les écrits scientifiques. Par conséquent, tout article soumis pour sa publication dans le BRAB doit être préalablement soumis à une analyse de plagiat, en s’appuyant sur quelques plateformes de détection de plagiat. Le plagiat constaté dans tout article sera sanctionné par un retour de l’article accompagné du rapport de vérification du plagiat par un logiciel antiplagiat à l’auteur de correspondance pour sa correction avec un taux de tolérance de plagiat ou de similitude inférieur ou égal à sept pour cent (07%).
Respect de certaines normes d’édition et règles de présentation et d’écriture
Pour qu’un manuscrit soit accepté par le comité de rédaction, il doit respecter certaines normes d’édition et règles de présentation et d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) qualités fondamentales d’un article scientifique sont la précision (supprimer les adjectifs et adverbes creux), la clarté (phrases courtes, mots simples, répétition des mots à éviter, phrases actives, ordre logique) et la brièveté (supprimer les expressions creuses). Le temps des verbes doit être respecté. En effet, tout ce qui est expérimental et non vérifié est rédigé au passé (passé composé et imparfait) de l’indicatif, notamment les parties Méthodologie (Matériels et méthodes) et Résultats. Tandis que tout ce qui est admis donc vérifié est rédigé au présent de l’indicatif, notamment les parties Introduction, avec la citation de résultats vérifiés, Discussion et Conclusion. Toutefois, en cas de doute, rédigez au passé. Pour en savoir plus sur la méthodologie de rédaction d’un article, prière consulter le document suivant : Assogbadjo A. E., Aïhou K., Youssao A. K. I., Fovet-Rabot C., Mensah G. A., 2011. L'écriture scientifique au Bénin. Guide contextualisé de formation. Cotonou, INRAB, 60 p. ISBN : 978-99919-857-9-4 – INRAB 2011. Dépôt légal n° 5372 du 26 septembre 2011, 3ème trimestre 2011. Bibliothèque Nationale (BN) du Bénin.
Titre
Dans le titre se retrouve l’information principale de l’article et l’objet principal de la recherche. Le titre doit contenir 6 à 10 mots (22 mots au maximum) en position forte, décrivant le contenu de l’article, assez informatifs, descriptifs, précis et concis. Un bon titre doit donner le meilleur aperçu possible de l'article en un minimum de mots. Il comporte les mots de l’index Medicus. Le titre est un message-réponse aux 5 W [what (quoi ?), who (qui ?), why (pourquoi ?), when (quand ?), where (où ?)] & 1 H [how (comment ?)]. Il est recommandé d’utiliser des sous-titres courts et expressifs pour subdiviser les sections longues du texte mais écrits en minuscules, sauf la première lettre et non soulignés. Toutefois, il faut éviter de multiplier les sous-titres. Le titre doit être traduit dans la seconde langue donc écrit dans les deux langues français et anglais.
Auteur et Co-auteurs
Les initiales des prénoms en majuscules séparées par des points et le nom avec 1ère lettre écrite en majuscule de tous les auteurs (auteur & co-auteurs), sont écrits sous le titre de l’article. Immédiatement, suivent les titres académiques (Pr., Dr, DVM, MSc., MPhil. et/ou Ir.), les prénoms écrits en minuscules et le nom écrit en majuscule, puis les adresses complètes (structure, BP, e-mail, Tél. et pays) de tous les auteurs. Il ne faut retenir que les noms des membres de l’équipe ayant effectivement participé au programme de recherche et à la rédaction de l’article.
Résumé
Un bref résumé dans la langue de l’article est précédé d’un résumé détaillé dans la seconde langue (français ou anglais selon le cas) et le titre sera traduit dans cette seconde langue. Le résumé est une compression en volume plus réduit de l’ensemble des idées développées dans un document, etc. Il contient l’essentiel en un seul paragraphe de 200 à 350 mots. Le résumé contient une Introduction (contexte, Objectif, etc.) rédigée avec 20% des mots, la Méthodologie (type d’étude, échantillonnage, variables et outils statistiques) rédigée avec 20% des mots, les Résultats obtenus et leur courte discussion (résultats importants et nouveaux pour la science), rédigée avec 50% des mots et une Conclusion (implications de l’étude en termes de généralisation et de perspectives de recherches) rédigée avec 10% des mots.
Mots-clés
Les 3 à 5 mots et/ou groupes de mots clés les plus descriptifs de l’article suivent chaque résumé et comportent le pays (la région), la problématique ou l’espèce étudiée, la discipline ou le domaine spécifique, la méthodologie, les résultats et les perspectives de recherche. Il est conseillé de choisir d’autres mots/groupes de mots autres que ceux contenus dans le titre.
Texte
Le texte doit être rédigé dans un langage simple et compréhensible. L’article est structuré selon la discipline scientifique et la thématique en utilisant l’un des plans suivants avec les Remerciements (si nécessaire), conflits d’intérêt, contributions de chaque auteur et Références bibliographiques : IMReD (Introduction, Matériel et Méthodes, Résultats, Discussion/Résultats et Discussion, Conclusion) ; ILPIA (Introduction, Littérature, Problème, Implication, Avenir) ; OPERA (Observation, Problème, Expérimentation, Résultats, Action) ; SOSRA (Situation, Observation, Sentiments, opinion, Réflexion, Action) ; ESPRIT/SPRIT [Entrée en matière (introduction), Situation du problème, Problème précis, Résolution, Information appliquée ou détaillée, Terminaison (conclusion)] ; APPROACH (Annonce, Problématique (permutable avec Présentation), Présentation, Réactions, Opinions, Actions, Conclusions, Horizons) ; etc.
Introduction
L’introduction c’est pour persuader le lecteur de l’importance du thème et de la justification des objectifs de recherche. Elle motive et justifie la recherche en apportant le background nécessaire, en expliquant la rationalité de l’étude et en exposant clairement l’objectif et les approches. Elle fait le point des recherches antérieures sur le sujet avec des citations et références pertinentes. Elle pose clairement la problématique avec des citations scientifiques les plus récentes et les plus pertinentes, l’hypothèse de travail, l’approche générale suivie, le principe méthodologique choisi. L’introduction annonce le(s) objectif(s) du travail ou les principaux résultats. Elle doit avoir la forme d’un entonnoir (du général au spécifique).
Matériels et méthodes
Il faut présenter si possible selon la discipline le milieu d’étude ou cadre de l’étude et indiquer le lien entre le milieu physique et le thème. La méthodologie d’étude permet de baliser la discussion sur les résultats en renseignant sur la validité des réponses apportées par l’étude aux questions formulées en introduction. Il faut énoncer les méthodes sans grands détails et faire un extrait des principales utilisées. L’importance est de décrire les protocoles expérimentaux et le matériel utilisé, et de préciser la taille de l’échantillon, le dispositif expérimental, les logiciels utilisés et les analyses statistiques effectuées. Il faut donner toutes les informations permettant d’évaluer, voire de répéter l’essai, les calculs et les observations. Pour le matériel, seront indiquées toutes les caractéristiques scientifiques comme le genre, l’espèce, l’âge, le sexe, la variété, la classe des sols, etc., ainsi que la provenance, les quantités, le mode de préparation, etc. Pour les méthodes, on indiquera le nom des dispositifs expérimentaux et des analyses statistiques si elles sont bien connues. Les techniques peu répandues ou nouvelles doivent être décrites ou bien on en précisera les références bibliographiques. Toute modification par rapport aux protocoles courants sera naturellement indiquée.
Résultats
Le texte, les tableaux et les figures doivent être complémentaires et non répétitifs. Les tableaux présenteront un ensemble de valeurs numériques, les figures illustrent une tendance et le texte met en évidence les données les plus significatives, les valeurs optimales, moyennes ou négatives, les corrélations, etc. On fera mention, si nécessaire, des sources d’erreur. La règle fondamentale ou règle cardinale du témoignage scientifique suivie dans la présentation des résultats est de donner tous les faits se rapportant à la question de recherche concordant ou non avec le point de vue du scientifique et d’indiquer les relations imprévues pouvant faire de l’article un sujet plus original que l’hypothèse initiale. Il ne faut jamais entremêler des descriptions méthodologiques ou des interprétations avec les résultats. Il faut indiquer toujours le niveau de signification statistique de tout résultat. Tous les aspects de l’interprétation doivent être présents. Pour l’interprétation des résultats, il faut tirer les conclusions propres après l’analyse des résultats. Les résultats négatifs sont aussi intéressants en recherche que les résultats positifs. Il faut confirmer ou infirmer ici les hypothèses de recherches.
Discussion
C’est l’établissement d’un pont entre l’interprétation des résultats et les travaux antérieurs. C’est la recherche de biais. C’est l’intégration des nouvelles connaissances tant théoriques que pratiques dans le domaine étudié et la différence de celles déjà existantes. Il faut éviter le piège de mettre trop en évidence les travaux antérieurs par rapport aux résultats propres. Les résultats obtenus doivent être interprétés en fonction des éléments indiqués en introduction (hypothèses posées, résultats des recherches antérieures, objectifs). Il faut discuter ses propres résultats et les comparer à des résultats de la littérature scientifique. En d’autres termes c’est de faire les relations avec les travaux antérieurs. Il est nécessaire de dégager les implications théoriques et pratiques, puis d’identifier les besoins futurs de recherche. Au besoin, résultats et discussion peuvent aller de pair.
Résultats et Discussion
En optant pour résultats et discussions alors les deux vont de pair au fur et à mesure. Ainsi, il faut la discussion après la présentation et l’interprétation de chaque résultat. Tous les aspects de l’interprétation, du commentaire et de la discussion des résultats doivent être présents. Avec l’expérience, on y parvient assez aisément.
Conclusion
Il faut une bonne et concise conclusion étendant les implications de l’étude et/ou les suggestions. Une conclusion fait ressortir de manière précise et succincte les faits saillants et les principaux résultats de l’article sans citation bibliographique. La conclusion fait la synthèse de l’interprétation scientifique et de l’apport original dans le champ scientifique concerné. Elle fait l’état des limites et des faiblesses de l’étude (et non celles de l’instrumentation mentionnées dans la section de méthodologie). Elle suggère d’autres avenues et études permettant d’étendre les résultats ou d’avoir des applications intéressantes ou d’obtenir de meilleurs résultats.
Remerciements
Il s’agit de remercier ceux qui ont financé l’étude, collecté les données sur le terrain et facilité la bonne conduite des travaux de recherche ainsi que d’éventuels lecteurs critiques du manuscrit.
Conflits d’intérêt
Un des aspects cruciaux de l’éthique de la recherche qui nécessite la divulgation transparente des conflits d’intérêt, permet de maintenir l’intégrité de la recherche scientifique et assure la crédibilité des conclusions publiées. Par conséquent, il est plus qu’essentiel pour tout chercheur de divulguer honnêtement toute situation pouvant être perçue comme un conflit d’intérêt afin de préserver la rigueur scientifique et la confiance du public. Par exemple, il s’agit de mentionner si éventuellement le travail a des situations conflictuelles avec d’autres en cours et connues des auteurs.
Contribution des auteurs
Dans cette rubrique est renseignée la contribution substantielle de chaque auteur dans le processus d’élaboration de l’article. Il s’agit de la part de travail de chacun des auteurs depuis la conception du travail, la mobilisation des ressources, la collecte et l’analyse des données, la rédaction du manuscrit, etc.
Références bibliographiques
La norme Harvard et la norme Vancouver sont les deux normes internationales qui existent et régulièrement mises à jour. Il ne faut pas mélanger les normes de présentation des références bibliographiques. En ce qui concerne le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), c’est la norme Harvard qui a été choisie. Les auteurs sont responsables de l’orthographe des noms cités dans les références bibliographiques. Dans le texte, les publications doivent être citées de la manière suivante : Sinsin (2020) ou Sinsin et Assogbadjo (2020) ou Sinsin et al. (2007). Sachez que « et al. » est mis pour et alteri qui signifie et autres. Il faut s’assurer que les références mentionnées dans le texte sont toutes reportées par ordre alphabétique dans la liste des références bibliographiques.
Somme toute dans le BRAB, selon les ouvrages ou publications, les références sont présentées dans la liste des références bibliographiques de la manière suivante :
Pour les revues scientifiques :
- Pour un seul auteur : Yakubu, A., 2013: Characterisation of the local Muscovy duck in Nigeria and its potential for egg and meat production. World's Poultry Science Journal, 69(4): 931-938. DOI: https://doi.org/10.1017/S0043933913000937
- Pour deux auteurs : Tomasz, K., Juliusz, M. K., 2004: Comparison of physical and qualitative traits of meat of two Polish conservative flocks of ducks. Arch. Tierz., Dummerstorf, 47(4): 367-375.
- A partir de trois auteurs : Vissoh, P. V., R. C. Tossou, H. Dedehouanou, H. Guibert, O. C. Codjia, S. D. Vodouhe, E. K. Agbossou, 2012 : Perceptions et stratégies d'adaptation aux changements climatiques : le cas des communes d'Adjohoun et de Dangbo au Sud-Est Bénin. Les Cahiers d'Outre-Mer N° 260, 479-492.
Pour les organismes et institutions :
- FAO, 2017. L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2017 : Renforcer la résilience pour favoriser la paix et la sécurité alimentaire. Rome, FAO. 144 p.
- INSAE (Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique), 2015 : Quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH-4) : Résultats définitifs. Direction des Etudes Démographiques, Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique, Cotonou, Bénin, 33 p.
Pour les contributions dans les livres :
- Whithon, B.A., Potts, M., 1982: Marine littoral: 515-542. In: Carr, N.G., Whitton, B.A., (eds), The biology of cyanobacteria. Oxford, Blackwell.
- Annerose, D., Cornaire, B., 1994 : Approche physiologique de l’adaptation à la sécheresse des espèces cultivées pour l’amélioration de la production en zones sèches: 137-150. In : Reyniers, F.N., Netoyo L. (eds.). Bilan hydrique agricole et sécheresse en Afrique tropicale. Ed. John Libbey Eurotext. Paris.
Pour les livres :
- Zryd, J.P., 1988: Cultures des cellules, tissus et organes végétaux. Fondements théoriques et utilisations pratiques. Presses Polytechniques Romandes, Lausanne, Suisse.
- Stuart, S.N., R.J. Adams, M.D. Jenkins, 1990: Biodiversity in sub-Saharan Africa and its islands. IUCN–The World Conservation Union, Gland, Switzerland.
Pour les communications :
- Vierada Silva, J.B., A.W. Naylor, P.J. Kramer, 1974: Some ultrastructural and enzymatic effects of water stress in cotton (Gossypium hirsutum L.) leaves. Proceedings of Nat. Acad. Sc. USA, 3243-3247.
- Lamachere, J.M., 1991 : Aptitude du ruissellement et de l’infiltration d’un sol sableux fin après sarclage. Actes de l’Atelier sur Soil water balance in the Sudano-Sahelian Zone. Niamey, Niger, IAHS n° 199, 109-119.
Pour les abstracts :
- Takaiwa, F., Tnifuji, S., 1979: RNA synthesis in embryo axes of germination pea seeds. Plant Cell Physiology abstracts, 1980, 4533.
Thèse ou mémoire :
- Valero, M., 1987: Système de reproduction et fonctionnement des populations chez deux espèces de légumineuses du genre Lathyrus. PhD. Université des Sciences et Techniques, Lille, France, 310 p.
Pour les sites web : http:/www.iucnredlist.org, consulté le 06/07/2007 à 18 h.
Equations et formules
Les équations sont centrées, sur une seule ligne si possible. Si on s’y réfère dans le texte, un numéro d’identification est placé, entre crochets, à la fin de la ligne. Les fractions seront présentées sous la forme « 7/25 » ou « (a+b)/c ».
Unités et conversion
Seules les unités de mesure, les symboles et équations usuels du système international (SI) comme expliqués au chapitre 23 du Mémento de l’Agronome, seront acceptés.
Abréviations
Les abréviations internationales sont acceptées (OMS, DDT, etc.). Le développé des sigles des organisations devra être complet à la première citation avec le sigle en majuscule et entre parenthèses (FAO, RFA, IITA). Eviter les sigles reconnus localement et inconnus de la communauté scientifique. Citer complètement les organismes locaux. Nomenclature de pesticides, des noms d’espèces végétales et animales. Les noms commerciaux seront écrits en lettres capitales, mais la première fois, ils doivent être suivis par le(s) nom (s) communs(s) des matières actives, tel que acceptés par « International Organization for Standardization (ISO) ». En l’absence du nom ISO, le nom chimique complet devra être donné. Dans la page de la première mention, la société d’origine peut être indiquée par une note en bas de la page, p .e. PALUDRINE (Proguanil). Les noms d’espèces animales et végétales seront indiqués en latin (genre, espèce) en italique, complètement à la première occurrence, puis en abrégé (exemple : Oryza sativa = O. sativa). Les auteurs des noms scientifiques seront cités seulement la première fois que l’on écrira ce nom scientifique dans le texte.
Tableaux, figures et illustrations
Chaque tableau (avec les colonnes et lignes rendues visibles donc quadrillées) ou figure doit avoir un titre. Les titres des tableaux seront écrits en haut de chaque tableau et ceux des figures/photographies seront écrits en bas des illustrations. Les légendes seront écrites directement sous les tableaux et autres illustrations. En ce qui concerne les illustrations (tableaux, figures et photos) seules les versions électroniques bien lisibles et claires, puis mises en extension jpeg avec haute résolution seront acceptées. Seules les illustrations dessinées à l’ordinateur et/ou scannées, puis les photographies en extension jpeg et de bonne qualité donc de haute résolution sont acceptées. Les places des tableaux et figures dans le texte seront indiquées dans un cadre sur la marge. Les tableaux sont numérotés, appelés et commentés dans un ordre chronologique dans le texte. Ils présentent des données synthétiques. Les tableaux de données de base ne conviennent pas. Les figures doivent montrer à la lecture visuelle suffisamment d’informations compréhensibles sans recours au texte. Les figures sont en Excel, Havard, Lotus ou autre logiciel pour graphique sans grisés et sans relief. Il faudra fournir les données correspondant aux figures afin de pouvoir les reconstruire si c’est nécessaire.